 Modification
de la répartition du volume sanguin
Modification
de la répartition du volume sanguin
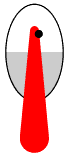 |
Voici une
représentation schématique de la distribution
des volumes des poumons (en blanc), de la masse
sanguine (en rouge), du coeur (en noir) et de
l'abdomen (en gris) chez un sujet debout "au
sec", donc soumis au champ de pesanteur
terrestre. L'abdomen et la masse sanguine sont
attirés vers le bas par la pesanteur (la
répartition du volume sanguin n'est pas la même
lorsqu'on est allongé). Il est important de
noter pour la suite que les organes représentés
sont souples, déformables et que leurs positions
respectives résultent d'un équilibre de forces
(pesanteur, élasticité, pressions relatives). |
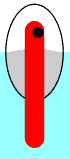 |
Si on
s'immerge partiellement, la pression
hydrostatique (pression relative) est
immédiatement transmise à la partie du corps qui
se trouve dans l'eau. Pour qu'un nouvel
équilibre des forces s'installe, un plus grand
volume sanguin va se retrouver là où les
vaisseaux sont le plus extensibles : les
capillaires des poumons. Ceux-ci peuvent se
dilater plus facilement que n'importe quels
autres vaisseaux, sans déplacer d'autres tissus,
car ils sont à proximité d'une masse gazeuse :
l'air contenu dans les poumons. Le coeur étant
lui aussi situé dans cette région, verra son
volume augmenter. |
 |
Lorsqu'on est
totalement immergé, 700 ml de sang
supplémentaires se retrouvent répartis dans les
poumons et le coeur. Le volume des poumons est
également réduit par le déplacement du
diaphragme vers le haut (la poussée d'Archimède
compense le poids de l'abdomen). Par ailleurs,
le tissu pulmonaire gorgé de sang perd de sa
souplesse. On voit donc que le simple fait de
s'immerger modifie le travail du coeur (volume
cardiaque plus important), l'efficacité
respiratoire (volume pulmonaire moindre) et
l'effort inspiratoire (poumons moins souples). |
|
 Augmentation de la pression sanguine
Augmentation de la pression sanguine
Dans le
corps en immersion, toutes les pressions relatives augmentent.
Le déplacement sanguin est quasi-instantané au moment de
l'immersion. Le sang en provenance des organes et qui arrive au
coeur est habituellement à une pression relative nulle. En
immersion, cette pression est de 10 mm Hg. L'afflux sanguin du à
l'immersion augmente donc la pression dans les veines, entraîne
un bon remplissage du coeur et facilite son travail. Le résultat
est une augmentation de la pression sanguine dans les artères.
La pression dans les artères est contrôlée en permanence. Comme
celle-ci augmente trop, un mécanisme de régulation entre en
jeu : le rythme cardiaque diminue et le diamètre des artères
augmente.
 Le choc thermo différentiel
(hydrocution)
Le choc thermo différentiel
(hydrocution)
On vient de
voir que l'augmentation de la pression dans les artères
déclenche une réaction réflexe qui ralentit le coeur et élargit
les artères. Ces réactions sont le fait du système nerveux
parasympathique. C'est lui qui intervient dans
le mécanisme du choc thermo différentiel.
Sous l'action
de la chaleur externe, les vaisseaux s'ouvrent sous la peau afin
de favoriser la dissipation de la chaleur corporelle. La
fréquence cardiaque augmente alors pour pouvoir convenablement
alimenter ce volume de vaisseaux ouverts. Si après une longue
exposition au soleil on se jette à l'eau, la chute de
température va provoquer une fermeture des vaisseaux
périphériques (vasoconstriction). Le grand volume sanguin va
donc refluer vers l'intérieur du corps : la pression sanguine va
augmenter brutalement, générant une réaction toute aussi brutale
du système parasympathique qui peut arrêter le coeur en quelques
secondes !
 Déshydratation accélérée
Déshydratation accélérée
La
noradrénaline est une hormone qui participe à
l'augmentation de la pression sanguine lorsque c'est nécessaire.
Elle est secrétée lorsque le système nerveux
orthosympathique le commande. Le système
orthosympathique est chargé d'augmenter la fréquence cardiaque
et de donner du tonus aux muscles qui commandent la fermeture
des petites artères. Bref, c'est un système qui augmente la
pression sanguine. Le système orthosympathique et le système
parasympathique se passent le relais en fonction des conditions
et des exigences du moment.
En
immersion, on a vu que c'est le système parasympathique qui est
en éveil. Le corps contient donc peu de noradrénaline. Cette
faible concentration de noradrénaline va avoir une conséquence
sur les cellules de la paroi de nos vaisseaux : ces cellules
vont s'écarter les unes des autres au point que l'espace
interstitiel (espace entre les cellules) sera sensiblement plus
grand qu'à l'habitude. L'eau du corps pourra alors rejoindre le
sang plus facilement, ce qui aura pour effet d'augmenter le
volume du plasma sanguin (hyper volémie). Quand le volume
plasmatique augmente, la diurèse (production d'urine) augmente
également car il y a plus de sang à filtrer. Le débit urinaire
qui est normalement de 1 ml / minute passe à 6 ml / minute en
immersion !
 Meilleure
élimination de l'azote
Meilleure
élimination de l'azote
Quand on sort
de l'eau, les pressions relatives reprennent leurs valeurs
normales et les vaisseaux reprennent peu à peu leur taille
initiale. La déshydratation a augmenté la viscosité du sang et
rend par conséquent plus difficile l'élimination de l'azote.
C'est pourquoi il est conseillé de boire de l'eau immédiatement
après la plongée.
En conclusion
une petite remarque sur notre état entre l'arrivée en surface et
le retour sur le bateau. Nous sommes dans l'eau jusqu'au cou,
presque entièrement immergés, nos vaisseaux sanguins sont bien
ouverts (sauf près de la peau s'il fait froid), l'espace entre
les cellules permet une circulation facile des liquides... Ce
sont d'excellentes conditions pour éliminer l'azote ! |
